La rédaction du site A l’Encontre a transcrit l’entretien entre Ruth Stégassy et l’auteur québécois Alain Deneault. Ruth Stégassy anime l’émission Terre à terre, émission qui passe, tous les samedis matin, à 7h05, sur France Culture. Nous donnons la parole à Ruth Stégassy: «Nous faisons ce matin, 18 février 2012, un petit tour au Québec avec le livre d’Alain Deneault tout juste paru : «Faire l’économie de la haine, point de haine de l’économie là où on nous fait aimer l’argent à tout prix. Point de haine de l’économie mais une économie de la haine. Le programme : faire l’économie de la haine. Haïr sans qu’il y paraisse. Ainsi investit-on dans l’asservissement à l’argent.» Cette citation, Alain Deneault, elle est tirée de votre dernier livre, Faire l’économie de la haine, paru aux Editions Ecosociété, en novembre 2011. Il y en a eu un certain nombre de ce genre de livres, on va les survoler, tous. Vous allez nous raconter ce que vous y avez mis. Il y a eu Offshore. Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, qui été également publié en France (Editions La Fabrique, avril 2010). Et Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique (Editions Ecosociété, juin 2008) qui a eu une étrange histoire que vous nous raconterez et puis Paul Martin et compagnies (Editions Vib, septembre 2005), un livre très québécois qui raconte une histoire bien de chez vous.
Ruth Stégassy: On ne va peut-être pas commencer par Paul Martin, mais peut-être par ce que vous entendez par «faire l’économie de la haine».
Alain Deneault: C’est une expression polysémique que je me suis permise à l’occasion du troisième anniversaire d’un livre antérieur, Noir Canada, qui a fait l’objet de poursuites vivement commentées dans l’opinion. Donc à l’occasion d’un récital de textes – qui mettait en présence des griots africains, des poètes québécois, des intervenants de la sphère publique, des comédiens et ainsi de suite – on m’avait demandé de faire quelque chose d’un peu littéraire, ce qui n’était pas tout à fait dans mon créneau. Autour de cette ambiguïté, je me suis permis de décliner un certain nombre de cas, d’illustrer des situations troublantes: à savoir qu’aujourd’hui, les mêmes acteurs influents de la sphère financière, industrielle et économique ne se comporteraient pas d’une autre façon s’ils étaient haineux. Disons-le comme cela.
C’est-à-dire que les structures mêmes de l’économie de marché, je dirai même les dispositifs psychiques qui sont à l’œuvre dans les opérations financières et industrielles mondiales permettent un tel degré de censure quand il en va des conséquences de l’industrialisation dans un monde mondialisé tel qu’on le connaît. Qu’ils permettent à ces acteurs d’arriver aux résultats de politiques haineuses, sans en passer par le sentiment lui-même! Cela signifie que l’on peut faire l’économie de la haine tout en menant des opérations qui ressemblent à tous points de vue à des opérations de haine contre des populations que l’on n’en finit pas d’enfoncer au stade de l’ignominie, là, en les exploitant par toutes sortes de moyens, de techniques, de stratagèmes et de prétextes.
R.S: C’est évidemment très évocateur, mais on a envie d’exemples, là, Alain Deneault.
AD: Quand une société minière ou pétrolière fera semblant de mener des recherches sur les conséquences sociales et environnementales de ses projets d’exploitation, quand elle fera semblant de mener des consultations, quand ostensiblement elle méprisera des populations sous prétexte que les paysans sont analphabètes ou les peuplades sont aux abois pour des investissements internationaux ou de la création d’emplois; lorsque l’on jouera aux ignorants par rapport aux conséquences évidentes de l’exploitation, du pétrole ou de l’or par exemple, et que l’on mènera à la disparition de ces peuples, à ce moment-là on pourra dire qu’il en va d’une économie qui, au fond, s’attaque à la vie.
Là il y a un grand problème d’ambiguïté, une grande confusion entre deux concepts, à savoir qu’aujourd’hui on confond économie et finance. La finance vise très exactement à consolider l’enrichissement des quelques-uns qui connaissent les rudiments du système, strictement en s’engonçant, en s’enfermant dans des considérations comptables, numériques, chiffrées qui rendent aveugles quant aux conséquences de ces opérations pour ceux qui en profitent.
L’économie c’est tout autre chose. C’est la science des «relations bonnes». Et le concept même d’économie, si l’on se rappelle son histoire – et on n’a pas besoin de remonter jusqu’aux Grecs comme on le fait souvent dans une sorte de télescopage –, le concept d’économie dans la modernité européenne a concerné plusieurs champs d’activités culturelles et sociales et scientifiques. Au XIXe siècle, en Allemagne par exemple, le concept d’économie n’était pas un concept relevant strictement des sciences économiques, mais il appartenait à la sociologie, à la philosophie, à la médecine, au droit, à la littérature, à la théologie. Toutes les sphères avaient leurs économies avec les concepts afférants de circulation, de valorisation et ainsi de suite. Et même, quand, en Allemagne, les premiers économistes de l’économie du marché intérieur se sont intéressés aux concepts fondamentaux de l’économie, on s’est référé à la façon dont on pensait l’économie en philosophie. C’est ce que mes travaux sur Georg Simmel (1858-1918) m’ont permis de comprendre.
R.S.: C’est assez troublant de vous entendre dire cela. On a le sentiment aujourd’hui d’être envahi par l’économie, que l’économie a envahi tous les champs. Or, si je vous suis bien, vous dites exactement l’inverse. Vous dites que non seulement elle n’a pas envahi tous les domaines de la vie, mais même qu’elle se serait rabougrie à une stricte définition financière de ce qu’elle est, était ou n’est pas.
A.D.: Tout à fait, exactement. Et on peut considérer que tout citoyen est habilité à parler d’économie et qu’il ne s’agit pas d’une discipline très complexe qui serait l’apanage de quelques experts maîtrisant la mathématique très poussée et ainsi de suite. L’économie est à la portée des romanciers, des psychanalystes, des sociologues… mais aussi de tout citoyen qui est lié, de fait, à des décisions économiques qui ne seraient que les siennes. Et aussi quant aux vicissitudes de l’économie dans sa vie. Ce qui est aussi curieux avec l’économie c’est qu’elle est cette pseudoscience des comportements d’agents qui ne sont pas des économistes. Alors forcément ce sont ces agents qui font l’économie et non les économistes ; on peut considérer que l’on est tous, à titre égal, aptes à penser la chose.
Mais, en même temps, tout est fait pour que penser l’économie soit de plus en plus difficile parce que l’on soustrait à la conscience publique un grand nombre de données relatives justement à l’économie au sens meilleur du terme, soit des «relations bonnes», au profit de la stricte finance opacifiée, au point de vue notionnel et conceptuel comme j’en ai parlé. Mais aussi, du fait d’un enjeu essentiel au XXIe siècle que sont les paradis fiscaux et ce que j’appelle plus largement les législations de complaisance.
La moitié des transactions financières transitent par les paradis fiscaux. Et, grosso modo, la moitié du stock mondial d’argent se trouve consigné dans des législations qui échappent à tout contrôle public. Et ça, contrairement à une espèce d’imagerie populaire, ce ne sont pas seulement des pirates modernes qui confisquent leurs butins pour, en quelque sorte, les planquer sur quelque île exotique à la manière donc des pirates d’un autre temps. Il s’agit au contraire de banques, d’industriels, d’investisseurs, de mafias…
R.S.: De gouvernements dites-vous également…
A.D.:… plus au moins. C’est-à-dire qu’il pourrait effectivement y avoir, par exemple, des services secrets d’instances gouvernementales qui, dans l’opacité de législations parallèles, mèneront des activités aux conséquences lourdes et graves pour des populations du monde. C’est-à-dire que pendant que les Etats de droit, bon an mal an, nous font croire qu’ils sont souverains, qu’ils prennent des décisions qui ont un effet sur nos vies, il y a en marge de ces Etats de droit que sont le Canada, la France, l’Espagne, l’Allemagne, et ainsi de suite…, des législations fantoches comme les Bahamas, les îles Seychelles, Monaco et, Dieu, soit la City de Londres – qui est un périmètre dans la grande ville. Ce sont des législations en quelque sorte adaptées aux intérêts du «laisser-faire» du grand capital.
Qu’est-ce que fait donc, à ce moment-là, un acteur devenu un souverain de la finance dans des législations de ce type? Il a à sa disposition tout le système bancaire; il a à sa disposition un droit informel, une sorte de service de notariat que sont les chambres de compensation (dont a beaucoup parlé le journaliste Denis Robert – auteur, entre autres, de Clearstream, l’enquête (Éditions Arènes, 2006); il a à sa disposition tout le transport maritime par le réseau des ports francs; il a à sa disposition également une main-d’œuvre à bon marché, dans les zones franches où on peut créer des industries sans respecter les normes minimales du droit du travail et sans qu’il y ait évidemment de syndicats. Et il a également accès à tout un univers comme, par exemple, celui du mercenariat, du trafic d’armes qui permet tout à fait de financer soit des rebelles en armes dans des zones en guerre, comme en Sierra Leone [de 1991 à 2002], au Congo Kinshasa, ou de financer des chefs d’Etat aux abois pour des financements et des armes, dans des contextes où on cherche à faire mainmise sur des ressources. On a donc là tout un système parallèle qui rend les acteurs offshore souverains, souverains dans la mesure où ils peuvent prendre des décisions qui ont des effets dans l’histoire, c’est ça être souverain, bon.
R.S.: Comment s’articule cette souveraineté avec celle des Etats, justement ?
A.D.: Elle s’articule avec celle des Etats dans la mesure où les représentants des Etats se sont montrés – à part quelques bombages de torse ici ou là à l’occasion de sommets comme le G20 et autres – très complaisants. Très très complaisants. On nous fait croire, c’était la phrase de Nicolas Sarkozy en septembre 2009 à l’occasion du sommet du G20 à Pittsburgh, qu’en aménageant deux ou trois technicalités [anglicisme : formalités, procédures techniques] auprès des banques on supprimerait les paradis fiscaux. Tout cela relève d’un délire. Les paradis fiscaux, en quelque sorte, consignent des capitaux. Par exemple Raymond W. Baker [ Le talon d’Achille du capitalisme, Ed. alTerre, 2007, pour la traduction française; directeur de Global Financial Integrity, Washington] parle de 1500 milliards de dollars d’argent blanchis qui transitent chaque année par les paradis fiscaux. On a donc des fonds colossaux qui servent à l’industrie et qui servent à ceux que les pays courtisent quand vient le temps de chercher du financement international pour financer l’économie locale.
On est dans une inversion des rapports : ce ne sont pas les Etats qui encadrent l’économie, mais les investisseurs internationaux, les banquiers internationaux, les grandes firmes internationales. Et qu’est-ce qu’on voit apparaître à l’échelle internationale? Ce sont des chefs d’Etat qui sont en fait des courtiers qui vendent des avantages juridictionnels et législatifs à des investisseurs internationaux qui sont devenus des souverains. Qu’est-ce qu’on fait au Québec? Qu’est-ce qu’on fait en France? Qu’est-ce qu’on fait partout ? «Venez, venez ô investisseurs internationaux, nous allons subventionner vos pseudo créations d’emplois, nous allons vous donner accès à nos ressources quasiment gratuitement.» Ici on dira, vous aurez l’électricité à peu de frais; vous aurez évidemment des exemptions fiscales et tout ce que vous pouvez imaginer d’avantages… Et dans dix ou quinze ans vous nous laisserez un paysage absolument dévasté et lunaire et on fera semblant d’être surpris. En France, on aura un peu la même chose: «Venez acheter nos produits technologiques»! Il y a d’autres façons de le tourner. Mais, la question essentielle, ici, est la suivante: on a des chefs d’Etat – et c’est assez important pour des populations – qui se promènent comme des courtiers qui, en fait, vendent une main-d’œuvre à bon marché, des avantages législatifs et un accès aux ressources sur un mode complètement soumis.
D’une part, parce qu’il y a un rapport de forces qui est à l’avantage d’une planète financière qui s’est complètement autonomisée dans l’histoire au cours du XXe siècle et, d’autre part, c’est plus sociologique, parce que les représentants des Etats proviennent précisément des milieux sociaux qui profitent des paradis fiscaux. Ce sont des économistes, ce sont… si vous prenez par exemple le Canada qui est lui-même un paradis réglementaire de l’industrie minière mondiale, tous les premiers ministres depuis Joe Clark [juin 1979 -mars 1980 du Parti progressiste-conservateur], tous les premiers ministres au terme de leur carrière politique travaillent pour ou dans l’industrie, notamment minière. On voit très bien qu’il y a une espèce d’apparentement entre ces milieux qui fait qu’un chef d’Etat, au fond, travaille plus à agencer la législation qu’il a en charge afin de favoriser l’essor du grand capital international que pour le bien de «ses» peuples.
«Le Devoir», 14 août 2010: « Le projet de loi promis par Québec pour encadrer l'exploitation des gaz de schistes n'a pas encore été présenté, ni même débattu, tandis que de plus en plus de citoyens s'inquiètent des impacts de l'exploitation de cette source d'énergie fossile. Qu'à cela ne tienne, la société albertaine Questerre Energy espère tirer profit de ses premiers puits en sol québécois d'ici la mi-2011. Gaz Métro a d'ailleurs déjà demandé des autorisations gouvernementales pour les brancher à son réseau.»
R.S.: Il y a tout de même une partie de ce travail qui consiste à organiser un discours qui soit joli, recevable, acceptable pour les populations. Je lisais dans Le Devoir [quotidien québecquois] qu’un des animateurs du site Ethical (sic !) Oil voué à la promotion des sables bitumineux canadiens travaillerait dorénavant pour le premier ministre, Stephen Harper [premier ministre depuis 2006]. Ce site Ethical Oil a réussi à promouvoir l’idée que le pétrole provenant des sables bitumineux était éthique parce que, contrairement à celui qui vient du Moyen-Orient, il ne finance pas l’oppression des femmes. Vous connaissiez cette histoire ?
A.D.: C’est tout à fait typique de cette poésie d’affaires que nous servent les lobbies jamais à court d’amalgames abracadabrants pour faire passer ou pour déguiser n’importe quel projet hautement controversé du point de vue même des scientifiques les plus chevronnés en une sorte de progrès social et environnemental. On est très habitué, ici comme ailleurs, à ce nettoyage au vert, ce que l’on appelle en anglais le «green washing», ce qui est intéressant sur cette question-là, au-delà de cet enjeu, c’est de se rendre compte, au fond, de ce qu’on oublie souvent: notre législation au Canada! On oublie, ici, étant donné un maquillage d’inspiration vaguement pseudo-républicaine – qui a eu lieu dans les années 1960 et 1970 dans notre Etat – que nous avons été et restons une colonie. Au fond, qu’est-ce qu’une colonie? C’est un Etat qui n’a aucune réserve pétrolière, qui se donne à tout investisseur pétrolier qui a les moyens de faire main basse sur nos ressources. Et tout cela nuit beaucoup à la prise de conscience politique que l’on pourrait souhaiter d’une population qui n’a pas de récit fondateur.
L’indépendance du Canada a été votée, à coups de décisions successives (depuis 1867, jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle) au Parlement de Londres. Franchement, comme mythe fondateur il y a plus sexy… On se retrouve, en fait, dans une législation qui a vu son indépendance votée par un autre Parlement (la conquête britannique date de 1763) et qui, au fond, n’a pas de ressort historique pour se positionner collectivement par rapport à des enjeux qui concernent un territoire immense dont le peuplement est à peu près ingérable. Il a été effectué par les populations qui ont été historiquement des colons, c’est-à-dire des agents de la colonie dépêchés sur place pour exploiter les ressources au détriment des populations premières, qui étaient les Amérindiens et sans avoir cette espèce d’engagement subjectif qu’ont les citoyens dans une république. Comme la monarchie constitutionnelle que nous sommes, ainsi qu’on la nomme pour trouver un euphémisme à une colonie, vise en fait à faciliter l’exploitation des ressources – un peu comme au Congo – on se trouve dans une position où on voit, encore et toujours, des sociétés étrangères exploiter les ressources.
Là c’est le plan nord au Québec pour exploiter les mines du nord: c’est le gouvernement du Québec qui finance des routes qui permettent à des industries d’exploiter, sans payer de redevances au gouvernement, un patrimoine minier que l’on voit donc en quelque sorte quitter notre sous-sol sous nos yeux, sans que l’on puisse réagir. Nous sommes toujours dans cette situation historique, qui nous place, nous les citoyens, dans la position des agents de la colonie et non comme des sujets agissant sur un plan collectif à l’échelle national.
R.S.: Des courtiers, des agents… c’est une société asservie que vous nous décrivez. On va rester un peu au Canada. Je vous promets que nous n’y resterons pas complètement, parce que je ne voudrais pas non plus que l’on donne l’idée que le Canada est particulièrement terrible sous ce rapport. Je pense que vous trouverez moult exemples qui nous permettront d’élargir, tout à l’heure, votre approche. Mais je voudrais qu’on y reste un peu puisque vous venez d’évoquer cette question de mines et c’était le sujet d’un livre que vous avez co-écrit avec William Sacher et Delphine Abade Noir Canada, qui a une curieuse histoire, comme je le disais tout à l’heure, que vous avez un peu évoquée. C’est donc au troisième anniversaire de la publication de ce livre, Noir Canada.
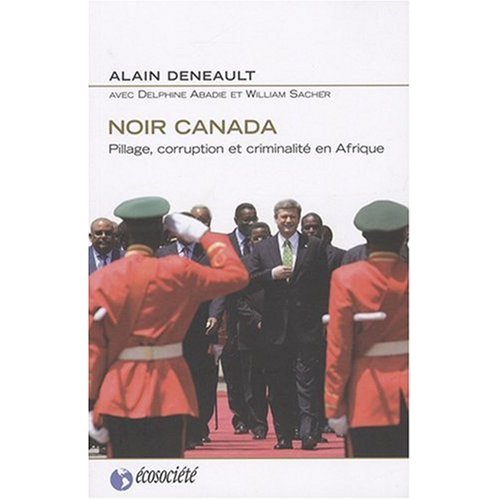 A.D.: Ce livre-là relate une histoire qui est celle de l’exploitation minière au Canada et il a lui-même son histoire. Il a une sorte de mise en abîme parce que son histoire est un peu annoncée dans le contenu même du livre.
A.D.: Ce livre-là relate une histoire qui est celle de l’exploitation minière au Canada et il a lui-même son histoire. Il a une sorte de mise en abîme parce que son histoire est un peu annoncée dans le contenu même du livre.
Par où commencer? Bon, disons déjà qu’historiquement le Canada, notamment, est un « minéralo-Etat »; disons-le comme cela. C’est-à-dire, historiquement la colonie canadienne a été dédiée tout à fait à l’exploitation par des monopoles institués par les gouvernements des ressources minières – et d’autres ressources notamment, mais principalement minières. Il y avait donc un Etat qui, vu ses institutions, apparaît pour soutenir ces industries-là. On a créé du chemin de fer, on a aménagé les Bourses; on a créé tout un cadre qui permettait d’exploiter des ressources, au départ au profit des forces coloniales. Nous avons un destin colonial.
On a créé une législation tout à fait avantageuse à cette exploitation-là. Et, au milieu des années 1990, les cours des minerais n’étant pas aussi élevés qu’avant, les mines étant moins riches qu’avant, la mondialisation par ailleurs se développant, on a décidé de mondialiser le modèle canadien. C’est-à-dire de faire en sorte que les investisseurs du secteur minier du monde s’enregistrent au Canada.
C’est pour cela qu’aujourd’hui 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. Trois sociétés minières au monde sur quatre sont canadiennes, sont enregistrées au Canada. Donc, on est venu de Suède, d’Israël, de Belgique, d’Australie, des Etats-Unis… pour enregistrer des sociétés ici parce qu’on a, à partir des années 1990, développé un cadre avantageux pour cette industrie-là ; soit un cadre réglementaire et un cadre judiciaire.
R.S.: Est-ce que l’on pourrait appeler cela de l’offshore minier?
A.D.: Oui, tout à fait. Sans trop insister toutefois sur la question strictement fiscale. Le problème que l’on a avec les paradis fiscaux et toutes les législations offshore c’est qu’on les identifie parfois beaucoup à la stricte question fiscale. Elle est très importante, évidemment, mais elle n’est pas la seule. Il y a toute la question réglementaire, judiciaire qui est en cause.
Et le Canada, en cela, est un paradis judiciaire dans la mesure où toute société qui exploite dans le secteur minier à l’extérieur de nos frontières – et qui veut disposer d’une sorte de couverture réglementaire et judiciaire – trouve au Canada un endroit de prédilection. Parce que l’on peut venir s’enregistrer et bénéficier d’une sorte de climat d’affaires tout à fait favorable à Toronto pour le contexte minier. Il y a des Bourses tout à fait adaptées à la spéculation qui est propre à l’exploration minière. On peut engranger énormément de capitaux, parce qu’il y a ici des avantages fiscaux qui sont conférés aux financiers du domaine minier, de sorte que les investisseurs institutionnels sont encouragés à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine minier.
En 2008, 450 milliards de dollars qui ont été investis strictement sur des titres miniers au Canada. Ces sommes d’argent ce n’est pas seulement issu des investisseurs institutionnels au sens «abstrait», c’est en réalité l’argent des citoyens et des épargnants. C’est-à-dire que les fonds de retraite, les compagnies d’assurances, les banques, les fonds communs en tout genre sont amenés ici de par les incitations fiscales du gouvernement fédéral afin de placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine minier. Cela fait de Toronto en quelque sorte le bas de laine de l’industrie minière mondiale.
Il y a une sorte de pipeline d’argent qui part de Toronto et qui alimente en flux financiers tous les projets risqués du monde à l’extérieur de nos frontières. Ces projets sont très souvent controversés. Parce qu’en matière environnementale, en matière sociale, en matière politique, en matière de sécurité, ils provoquent parfois des catastrophes, en tout cas énormément de remous. Il suffit, à ce sujet, de lire la documentation internationale. Vous aviez donc quelqu’un, par exemple, comme Thierry Michel [voir le site : http://www.congo-river.com/index.php], qui est un réalisateur belge. Il a fait un film sur l’ancien Congo belge en relation avec les responsabilités contemporaines de la Belgique liées à un potentat belge, George Forrest, sur une mine détenue par des Belges [voir ci-dessous l’entretien-vidéo avec Thierry Michel].
Et là, il y a un ingénieur belge – on est dans un contexte belgo-belge à fond ici – qui dit: quand on veut du financement pour notre projet minier on va au Canada. Le documentaire ne portait pas sur le Canada et puis il ne parlait pas de Singapour, de Francfort par exemple. On n’était que dans cette logique voulant que l’industrie minière au monde trouve son financement au Canada. Ce financement-là, ce sont les épargnants canadiens [fonds de pension] qui le fournissent aux industries minières mondiales, alors que la législation canadienne, en même temps, fournit un cadre réglementaire et judiciaire. Et, elle empêche toute poursuite judiciaire en termes pratiques ou en termes de droits pour des abus que commettraient à l’échelle internationale ces sociétés.
Donc on les protège légalement, du point de vue de la réglementation et du point de vue de la finance. C’est donc un havre de l’industrie extractive mondiale. Ce que l’on a expliqué dans Noir Canada. Cela n’a pas plu à tout le monde étant donné que l’on a fait l’objet de poursuites [plainte en diffamation], d’une part, pour un montant de 6 millions de dollars de Barrick Old Corporation et, d’autre part, de 5 millions de dollars de…
R.S.: Six millions de dollars?
A.D.: Six millions de dollars de Barrick Old Corporation qui a finalement fait l’objet d’un règlement hors cour après trois années et demie de procédure [voir sous note 1 l’explication à ce sujet de l’éditeur]. Une autre cause, pendante, qui est celle de Banjo Corp. Cette fois dans une autre province canadienne, en Ontario, pour 5 millions de dollars.
R.S.: Vous avez fait l’objet de ce que vous appelez les «poursuites bâillons»? Est-ce que cela fait partie de cette réglementation si accueillante que vous étiez en train de nous décrire pour toutes ces opérations extraordinaires?
A.D.: Ce serait compliqué, je n’aurais pas qualifié ainsi les poursuites dont on a fait l’objet. Je peux dire, par rapport à Barrick Old Corporation, qu’il y a eu un jugement, le 12 août 2011, qui présentait la poursuite comme apparemment abusive. Et il y a, également, cette poursuite de Banjo. D’une manière générale, il y a eu au Canada beaucoup de débats sur ce que l’on appelle les «poursuites bâillons». Les environnementalistes ont été les premiers à soulever ce problème. C’est une notion intéressante sur laquelle j’avais fait une série d’interventions en France. Elle sert ceux qui estiment être victimes de «poursuites bâillon» dans la mesure où il s’agit d’une notion qui permet, en quelque sorte, de politiser un débat précisément face à des acteurs qui cherchent à le judiciariser.
La notion de «poursuite bâillon» permet de repolitiser ce que l’on veut dépolitiser. C’est ce que disait le juriste Pierre Noreau, professeur de droit à l’Université de Montréal [Centre de recherche en droit public – CRDP].Il indiquait que la mobilisation de la justice quant au débat public risque de priver de droits des acteurs qui ne font que se prévaloir de leur liberté d’expression. Pourquoi ? Parce que dans le système de droit britannique qui est en grande partie le nôtre – quoique nous ayons le Code civil au Québec – Pierre Noreau et aussi le professeur de droit, Pierre Trudel de l’Université de Montréal [CRDP] l’expliquent ainsi: la notion de réputation prend le dessus sur celle d’expression.
R.S.: C’est-à-dire ?
A.D.: C’est-à-dire que dans la hiérarchie des droits une firme qui estime être lésée du point de vue de sa réputation peut faire valoir ses droits au-delà de la notion de liberté d’expression.
Donc, en droit, la question de la diffamation a peu à voir avec le vrai ou le faux d’une démarche mais plutôt sur ce que l’on appellera l’intention de nuire, le fait d’atteindre une réputation. On entre là dans une discussion de droit qui m’apparaît, à moi, assez sibylline. Je pense qu’il devrait y avoir – et ce n’est pas encore le cas ici, malgré des avancées législatives – une loi qui immunise toutes les personnes qui participent au débat public. Comment on peut définir une personne qui participe au débat public ? C’est quelqu’un qui participe à des questions de société qui ne concernent pas ses intérêts propres. Lorsque je parle de l’Afrique, lorsque je parle des paradis fiscaux, je n’ai pas d’intérêts propres à défendre dans ce domaine. Je n’ai pas d’actifs en Afrique. Je ne suis pas en train d’orchestrer une carrière politique ou quoi que ce soit. Je m’intéresse à des questions comme partie prenante d’un sujet collectif que nous devrions considérer que nous constituons plutôt que de se voir sans cesse comme des stricts individus.
R.S.: C’est intéressant ce que vous dites-là. En France, nous avons cette conception sur ce qu’on a appelé les lanceurs d’alerte dans le domaine scientifique. C’est-à-dire que nous avons demandé cette immunité, cette protection – que vous êtes en train de décrire – pour tout ce qui est des scientifiques qui dénoncent tel ou tel problème de santé publique, tel ou tel risque que l’on fait peser sur les populations à leur insu. Vous, vous l’élargissez à l’ensemble de ceux qui nourriraient le débat public. C’est une sorte de volonté de repolitiser le débat, en effet, de manière très vigoureuse. Dirais-je.
A.D.: Oui… d’autant plus qu’il y a énormément de problèmes par rapport à la judiciarisation du débat public. Surtout dans le système d’inspiration britannique, l’argent est au cœur de la procédure judiciaire.
On peut donc transformer la simple procédure judiciaire en un châtiment envers ceux qui n’ont pas les moyens de se défendre. Quand tu as des avocats que tu vois travailler des semaines et des semaines sur des dossiers, qui ont des honoraires qui oscillent autour de 500 euros de l’heure, on peut bien imaginer qu’il n’y a plus que les millionnaires et les multinationales qui peuvent accéder à la justice!
Et il y a plusieurs problèmes qui en découlent en cascade. La justice ne se saisit que des problèmes qu’on lui soumet, en droit britannique; elle n’a pas de droit discrétionnaire. C’est donc toujours par rapport à la façon dont un justiciable va présenter une cause que la justice va réfléchir. Comme il n’y a que des millionnaires qui sont capables de soumettre à la justice des problèmes, les juges ne connaissent plus, sociologiquement, que des problèmes de riches.
Ils sont complètement, en quelque sorte, formatés par la façon dont l’immense majorité de millionnaires qui se présentent devant eux ont de présenter leurs problèmes. Il y a donc là des problèmes en série. Les gens qui disposent de peu de moyens – et même des gens de la «classe moyenne» – ne pourront jamais mobiliser la justice pour dire: s’il y a des sociétés canadiennes présentes à l’occasion des conflits militaires des Grands Lacs en Afrique – qui ont fait autour de six millions de morts – elles devraient peut-être faire l’objet d’un intérêt de la justice du pays. Ils n’auront jamais les moyens pour le faire. Ou presque. Ce sera toujours des combats qui n’en finissent plus par rapport à des procédures qui sont absolument lassantes. C’est de gros gros problèmes qui sont en cause. C’est pour cela que cette voie de la judiciarisation est assez vite stérile du moment que l’on a compris dans quel bourbier terminologique on en arrive dans ces arènes.
R.S.: Ce qui donne assez souvent un sentiment d’impuissance, aussi, pour suivre dans cette veine, c’est le sentiment qu’il y a, en face, un système qui est parfaitement verrouillé parce que – je pense à la forêt là, et à la déforestation: soit vous n’avez pas de lois et il est donc très facile de déforester tranquillement (vous n’avez pas le droit parce qu’il n’y a pas, par exemple, le droit de propriété reconnue ou sur telle ou telle portion de territoire) ; soit vous avez des lois et, là, elles sont tout simplement bafouées, détournées… Et donc, ce sentiment qu’entre légalité et illégalité, finalement la frontière est parfaitement brouillée. Il n’y a plus un côté qui serait un côté sûr et un côté qui soit le côté dangereux.
A.D.: Il y a un magistrat français, Jean de Maillard, qui a très bien réfléchi sur ces questions d’ambiguïté entre l’économie licite et l’économie illicite. Ses travaux sont très intéressants dans la mesure où, au départ, au début de sa recherche, il constatait un assaut, disons, de forces criminelles sur les structures institutionnelles traditionnelles.
A la faveur de la crise économique des «subprime» de 2008, on a constaté que l’économie licite elle-même fonctionnait de manière délinquante et qu’elle développait des méthodes, des structures, des agencements qui sont tellement singuliers, pour ne pas dire bizarres, qu’ils échappent au droit lui-même. C’est-à-dire que le droit n’arrive pas conceptuellement à appréhender la qualité ou le statut de constructions stratégiques, financières qui ressemblent plutôt au fruit du travail d’apprentis sorciers. Il y a donc là quelque chose qui échappe effectivement au droit.
Lorsque l’on analyse les relations iniques entre des firmes multinationales qui ont des actifs qui excèdent largement les produits intérieurs bruts des Etats et les dix Etats qui sont là, à genoux, à solliciter des financements internationaux, on se rend souvent compte que les contrats qui sont signés entre les dix Etats et les investisseurs étrangers ont valeur de lois, au-delà des droits constitutionnels votés par lesdites instances gouvernementales ou politiques.
Il y a donc ici tout un problème: c’est que l’on se retrouve en quelque sorte à négocier avec des industries qui savent, avec leurs armées d’avocats, comment faire la loi. Comment faire la loi? Ce n’est plus un retour à un Etat de nature, comme on pourrait le penser en théorie constitutionnelle, c’est une façon de réglementer le retour à l’Etat de nature. C’est une façon de faire passer dans la loi des états de non droit, c’est de voir la force des petits contrats. Je pourrai vous raconter au Canada comment, par des ententes entre des parties dans des cadres contractuels, on en arrive à amener des gens à abdiquer des droits pourtant reconnus par la Constitution. C’est-à-dire qu’on ne se rend pas compte, dans le cadre légal, il peut y avoir des éléments qui supplantent le cadre lui-même. Il y a un tel imbroglio conceptuel aujourd’hui…
R.S.: J’aimerai bien un exemple, là…
A.D.: Les environnementalistes qui ont signé des règlements à l’amiable dans le cadre de poursuites judiciaires ont été amenés à dire qu’ils avaient abdiqué des droits en termes de liberté d’expression. C’est-à-dire que, comme il y a un côté trop cher pour se présenter dans un cadre judiciaire, ces environnementalistes vont dire, dans le cadre d’un règlement hors cour auquel j’ai été forcé étant donné un rapport de forces inégal : «j’ai dû abdiquer des droits». Cela existe à mains égards.
Des Etats, ou des populations via leurs Etats, vont voir leurs propres droits constitutionnels bafoués parce que, tout d’un coup, un Etat aura signé, par exemple, un contrat permettant l’accès à des ressources à une société qui pourra se prévaloir des termes du contrat qui contredit des lois nationales. Vous avez par exemple un ministre québécois qui n’a pas pu dire quels étaient les termes d’une entente entre le gouvernement du Québec et une société pétrolière privée pour l’exploitation éventuelle de réserves pétrolières au large du fleuve Saint-Laurent. Cela parce qu’il y avait une clause de confidentialité entre le gouvernement du Québec et ladite société. Nous voyons là des avocats d’affaires, des juristes d’entreprise, des fiscalistes, etc. – selon les secteurs – qui créent, en quelque sorte, du droit, «du droit hors du droit» ou en accointance avec le droit. C’est là que l’on se rend compte du rapport entre le droit – qui devrait tellement faire l’objet d’une sociologie du droit rigoureuse et critique, ce que l’on attend beaucoup – et des institutions publiques complètement soumises aux règles de la finance internationale. On constate que ces institutions ne sont pas capables d’être souveraines par rapport aux enjeux qui les attendent historiquement.
Cette faiblesse va finir par entraîner au moins une sorte de désobéissance civile et une sorte de mobilisation autonome. Comme Frantz Fanon pouvait l’imaginer par exemple dans les colonies, où, là, la réponse par rapport à une inquiétude quant au bien public sera probablement violente, à terme. Quand les gens n’auront plus de poissons dans leurs eaux, quand ils vont se prendre des cancers de la peau à 15 ans, quand ils vont voir qu’ils sont complètement aux mains des «forces» qui sont celles de l’enrichissement infini des moins nombreux, ils vont comprendre qu’ils sont laissés à eux-mêmes. Alors, ils vont créer des institutions, selon la forme la plus traditionnelle, c’est-à-dire par insurrection.
R.S.: D’autant plus que l’on voit, effectivement, que la situation s’exacerbe. Je me demandais comment vous inscrivez dans le paysage de dévastation que vous êtes en train de nous dresser tout ce qui est la «financiarisation» de la nature. Aujourd’hui, justement, on assiste à la marchandisation de tous ces biens que sont l’eau, l’air; ce qu’on appelle les services éco-systémiques. Le fait de pouvoir filtrer de l’eau par des plantes, le fait que la présence d’une zone humide, par exemple, va réguler l’ensemble d’un bassin-versant, toutes ces choses. La vie.
A.D.: Je n’insisterai que sur un aspect de la question, à savoir la marchandisation, la financiarisation des différentes formes de vie. Lorsque l’on analyse comment se sont développées autant la connaissance de l’appareil psychique que la connaissance des stratagèmes boursiers, financiers, on se rend compte à quel point il y a une sorte de rapport spéculaire entre le refoulement, comme possibilité ou mécanisme de l’appareil psychique, et celui de la finance.
Lorsque l’on financiarise quelque chose on risque fort de chercher à en perdre conscience et de transformer cette chose, la déplacer d’un point de vue conceptuel de sa catégorie d’appartenance la plus sensée du point de vue de la pensée à une autre catégorie, à une catégorie inadaptée qui est celle de la commercialisation, de l’exploitation et ainsi de suite.
Je suis très sensible à cette phrase de Georg Simmel – en 1896, lorsqu’il préparait son grand-livre, La philosophie de l’argent – qui disait que dans des relations d’affaires, au fond, des acteurs vont être beaucoup plus brutaux quant aux opérations qu’ils mènent et jusqu’où ils vont que s’ils faisaient directement les choses. Il y a cette espèce d’écran que constitue l’argent, qui est un écran psychique. Lorsque l’on est confronté à des colonnes comptables, lorsque l’on est confronté à des résultats d’entreprise, lorsque l’on est confronté simplement à des opérations trimestrielles, lorsque l’on se soucie du sort des actionnaires, qu’est-ce qu’on fait?
On crée un microcosme auquel on soumet tout le reste, mais sans le voir, en le voyant simplement comme une matière première vouée à permettre des rendements. C’est cela la financiarisation d’un point de vue psychique. Et cette transformation économico ou financiaro-psychique de tout bien de référence est forcément un motif d’inquiétude pour tous ceux qui ont à cœur le bien public et ceux qui ont à cœur l’économie au sens noble, à savoir comment on pense des «relations bonnes» entre les choses.

- AngloGold Ashanti se présente. Alain Deneault: «Je prends un concept qui est emblématique entre tous, c’est celui de «bonne gouvernance». Comment voulez-vous penser avec un vocable pareil? Qui n’a aucune étymologie, qui ne renvoie à aucune mémoire historique, qui est tout simplement le participe présent substantifié du verbe gouverner, le participe présent étant le temps le plus faible et le plus insignifiant en français! C’est comme si plutôt que de parler de la promenade on choisit de dire la marchance.»
R.S.: Je voudrai que l’on revienne au titre de votre dernier livre, Faire l’économie de la haine, parce qu’effectivement on a l’impression d’avoir traversé une haine incroyable à vous écouter, une haine d’une violence inouïe et qui ne se dit pas, qui se tapit dans tout ce système, mais c’est une haine qui à quoi pour objet? L’humanité ? La terre ? La vie ?
A.D.: Déjà, c’est une haine dont on fait l’économie et qui ne se questionne même pas sur son objet et qui ne se manifeste pas non plus. Je veux dire, aujourd’hui, que quelqu’un de haineux peut simplement être un lecteur de journaux financiers qui est très gentil avec ses enfants, son chien, ses voisins, sa famille et ses employé·e·s même; et simplement laisser le système porter sur lui, l’odieux de situations que l’on a plus à assumer du point de vue de sa psyché. Il y a comme un transfert sur des instances impersonnelles que sont les personnes morales (firmes, société) ou toutes sortes d’institutions dans la sphère publique.
Il s’ensuit une censure insidieuse. En fait, on inculque, par la voie des journaux, de la conscience publique quels que soient ses biais, de l’éducation, des modalités de pensée, des formes cognitives qui sont censurantes à l’origine et qui nous empêchent de nommer un chat un chat, qui nous empêchent de voir l’ordre du monde dans sa cruauté et, par exemple, le développement des formes institutionnelles du champ économique comme étant aberrante.
On n’est plus capable, lorsque l’on essaie de quitter ces chantiers battus des notions toutes faites que l’on nous demande d’utiliser, notre voix tremble, on se sent isolé et ainsi de suite. Je prends un concept qui est emblématique entre tous, c’est celui de «bonne gouvernance». Comment voulez-vous penser avec un vocable pareil? Qui n’a aucune étymologie, qui ne renvoie à aucune mémoire historique, qui est tout simplement le participe présent substantifié du verbe gouverner, le participe présent étant le temps le plus faible et le plus insignifiant en français!
C’est comme si plutôt que de parler de la promenade on choisit de dire la «marchance». C’est cela la gouvernance, c’est cesser de parler de politique, c’est cesser de parler de rapports de force, c’est cesser de parler de rapports de classes, c’est cesser de parler de citoyenneté, c’est cesser de parler de responsabilité et de bien public, de bien commun, pour parler d’une sorte de modalité de gestion des choses en tant qu’elle serait des intérêts partagés par des partenaires. C’est exactement ce que nous dit cette théorie de la gouvernance.
Et on nous amène aujourd’hui à l’utiliser pour penser des situations politiques, historiques, d’une complexité inouïe. Et donc on nous rend bête avec des notions qui sont des passages obligés de la pensée publique autant dans le domaine de l’école primaire, secondaire et universitaire que politique et gouvernemental. Même les organisations non gouvernementales, qui cherchent du financement, sont obligées d’utiliser ces notions-là. C’est un exemple entre mille.
On nous rend bête et ce n’est pas seulement qu’on nous rend bête, mais c’est que l’on nous amène par ces structures cognitives à développer nous-mêmes nos modalités censurantes. La censure, aujourd’hui, participe de l’économie de la haine. Du fait de faire l’économie de la haine, la censure aujourd’hui n’est pas de l’ordre des anciens bureaux de censure que l’on connaissait, qui raturaient des passages que l’on était à même de concevoir, elle est infraconsciente, c’est qu’elle nous amène en quelque sorte à nous-mêmes nous interdire ce qu’il faudrait dire pour arriver à des constats nécessaires qui soient de l’ordre d’un renouveau de l’activité publique.
R.S.: Empêcher de penser, empêcher de dire, empêcher même d’éprouver. On a l’impression d’une sorte d’anesthésie générale. Je pense là à un concept que vous avez développé, celui de «génocide involontaire». Si le génocide était volontaire on éprouverait tout de même un remords, en tout cas quelque chose, une émotion.
A.D.: Le «génocide involontaire» est une notion qui se calque sur la notion «d’homicide involontaire» et qui, au-delà de cette reprise, consiste à planifier. On est dans quelque chose de l’ordre du génocide, mais évidemment le génocide traditionnel et le génocide involontaire sont deux choses différentes. Mais ils participent, sourdement, d’un même mépris de certains peuples par rapport à d’autres et participent également d’une planification. Mais d’une planification, là, non pas volontaire de la mort des uns par les autres, en rapport à des appartenances culturelles ou disons raciales et autres; le «génocide involontaire» est une opération qui consiste à mépriser les conséquences vitales que peuvent avoir sur les peuples des projets industriels parce que ces peuples-là sont méprisables. Et donc, on va feindre, tout au mieux, de mener des études sur l’impact social, environnemental, et de santé publique sur des populations concernant des projets. Ainsi, on aura feint de mener des consultations. On crée des estimations frauduleuses, on crée des projets, et ainsi de suite.
On s’arrange à ne pas être conscient presque sciemment des conséquences de projets, parce qu’au fond telle population amérindienne de l’Equateur ou les Maliens de Yatéla [région avec des mines d’or] ne valent pas la chandelle. Là, il y a quelque chose de sourdement génocidaire qui se développe, dans la mesure où on est à même de savoir que ce que l’on entreprend d’un point de vue industriel. L’exploitation des mines et du pétrole va conduire à la disparition des peuples. On peut parler d’AngloGold et d’IAMGOLD [2] qui sont toutes les deux propriétaires d’un consortium au Mali qui a entraîné de telles conséquences environnementales, une telle nuisance à la santé publique que les femmes maliennes se sont mises à faire des fausses couches en série. Là on parle d’un génocide au sens étymologique, car on empêche la généalogie des peuples. Dans les seuls points d’eau potable de la région on a retrouvé de l’arsenic, du cyanure et ainsi de suite qui ont provoqué ce désastre en matière de santé publique.
Evidemment, il n’y a pas un industriel, il n’y a pas un gestionnaire qui a eu l’intention de tuer des peuples, mais on méprise tellement leur existence que l’on ne se pose même pas la question. Donc, on fait l’économie de la question de la vie des peuples environnant les points d’exploitation minière, pour extraire de l’or ou du pétrole
R.S.: L’antidote à cette économie de la haine? C’est de ne pas faire l’économie de la rage?
A.D.: Déjà, nous avons une responsabilité par rapport aux structures de refoulement qui sont mises en œuvre pour nous amener à ne pas voir les choses en face. Nous n’avons pas à être solidaires de modalités qui mènent à se comporter comme si nous étions haineux, alors que nous ne le sommes pas.
La participation que nous pouvons avoir comme «épargnant» [par le biais des fonds de pension] à des firmes industrielles qui sont destructrices doivent, à un titre ou à un autre, relever d’un fait de responsabilité quant à ceux qui peuvent, dans un premier temps, s’estimer dupés par un système et qui, dans un deuxième temps, prennent la responsabilité d’y réagir. C’est un premier point.
L’autre point c’est de cesser de se considérer comme de stricts individus, l’individualisme est une création institutionnelle et collective. On nous façonne comme individus pour nous faire oublier que dans l’histoire les sujets ont toujours été, d’une façon ou d’une autre, collectifs. Les «indignés» aujourd’hui à l’échelle planétaire forment une sorte de sujet collectif. Ce ne sont pas des individus qui ont décidé, sur une base individuelle, par hasard, un jour, de sortir dehors avec une tente et une pancarte. C’est un phénomène qui est difficile à analyser, mais qui existe bel et bien, de subjectivité collective qui est à l’œuvre.
C’était le cas en 1848, c’était le cas en 1968, c’est le cas encore aujourd’hui. Il y a quelque chose d’une subjectivité politique qui détermine ce que l’on pourrait appeler la souveraineté des peuples. Les peuples sont souverains eux aussi lorsqu’ils ont un impact sur le cours historique des choses, lorsqu’ils représentent une force décisive. Et c’est en n’oubliant pas que l’on n’est pas seulement des individus, isolés dans un sous-sol, à regarder la télévision que l’on peut faire la différence dans l’histoire.
Le troisième point consiste à réfléchir à la façon de rendre révolues des institutions absolument dénaturées, tellement corrompues. C’est tautologique, tant que l’on n’en reconnaît pas la nature. Et rendre révolues des institutions, c’est strictement faire la révolution. Je pense que l’on en est là.
Notes
[1] «Règlement de l’action de Barrick Gold contre les auteurs et l’éditeur de Noir Canada Barrick Gold Corporation (« Barrick »), Alain Deneault, Delphine Abadie et William Sacher (collectivement, les « Auteurs ») et Les Éditions Écosociété Inc. (« Écosociété ») annoncent qu’ils ont réglé hors Cour l’action en diffamation intentée par Barrick en avril 2008 en Cour supérieure du Québec en relation avec le livre Noir Canada: pillage, corruption et criminalité en Afrique (« Noir Canada ») écrit par les Auteurs et publié par Écosociété (l’« Action »). Afin de régler le litige qui l’oppose à Barrick, Écosociété met fin à la publication et l’impression de Noir Canada et a effectué un paiement significatif à Barrick. Une partie de Noir Canada se rapporte à des allégations concernant l’implication alléguée de Barrick en Tanzanie en 1996. Les Auteurs reconnaissent qu’ils n’ont pas de preuve d’implication de Barrick en Tanzanie en 1996 et que Barrick et d’autres parties contestent les allégations entourant les événements à la concession de Bulyanhulu en 1996. En relation avec le contenu de Noir Canada concernant le Congo, Barrick reconnaît que la thèse des Auteurs et de plusieurs autres personnes est à l’effet que la présence de plusieurs ressources minérales, dont l’or, au Congo était un des principaux motifs à l’origine des conflits dans ce pays et que la présence de compagnies minières transnationales dans une région en guerre, telle les Grands Lacs africains peut avoir des conséquences imprévues et sérieuses. Les Auteurs reconnaissent que bien que ces questions aient été étudiées de façon approfondie par un groupe d’experts des Nations Unies, en 2001-2002, ces experts n’ont fait aucune mention de Barrick. Les Auteurs reconnaissent que Barrick a présenté des documents et témoignages indiquant qu’elle n’a eu qu’une présence très limitée au Congo à l’été de 1996 exécutant du travail exploratoire sur une petite partie d’une concession minière de 82 000 km² au Congo et indiquant qu’elle n’a eu aucune implication dans les conflits au Congo. Les Auteurs reconnaissent qu’ils n’ont aucune preuve à l’effet contraire. Barrick, les Auteurs et Écosociété conviennent que l’Action instituée par Barrick et l’écriture et la publication du livre Noir Canada par les Auteurs et Écosociété ont été entreprises de bonne foi et avec la conviction qu’elles étaient légitimes. Les Auteurs réitèrent ce qu’ils ont écrit dans l’introduction de Noir Canada, à savoir que « cet ouvrage ne constitue pas une condamnation sommaire de sociétés » qu’il cite, et qu’ils ne s’étaient pas donnés pour mandat d’assurer ultimement la véracité des allégations que le livre développe à partir de documents publics. Les Auteurs maintiennent que Noir Canada a été écrit afin de susciter un débat public sur la présence controversée d’intérêts canadiens en Afrique et d’en appeler à la création d’une commission d’enquête sur cette présence canadienne en Afrique. Ils maintiennent toujours cette position et continuent de s’enquérir du rôle des sociétés privées actives en tant que partenaires commerciaux auprès de représentants politiques africains engagés dans des conflits armés. Écosociété considère que Noir Canada est pertinent et d’intérêt public, que la thèse qui y est développée constitue une contribution essentielle à la pensée critique et méritait d’être publiée. Écosociété entend poursuivre sa mission d’éditeur indépendant qui publie des essais d’intérêt public visant à susciter des débats de société.»
[2] Une illustration du rôle du Canada comme offshore minier se trouve dans le curriculum vitae du président du conseil et administrateur de IAMGOLD : William D. Pugliese. Ce dernier se décrit ainsi, sur le site de la firme : «M. Pugliese, homme d’affaires, est l’un des fondateurs de la Compagnie. De 1990 à 1993, il a occupé les fonctions de coprésident du conseil et de chef de la direction de la Compagnie. En janvier 2003, M. Pugliese a quitté le poste de chef de la direction et a conservé son rôle de président du Conseil. Il a participé directement à l’évolution de la Compagnie, notamment à la mise en valeur de la concession Sadiola au Mali par l’entremise de ses démarches auprès des représentants du gouvernement et ses partenaires de co-entreprises. M. Pugliese possède une vaste expérience du domaine des affaires, acquise sur une période de 35 ans en tant qu’actionnaire principal d’un certain nombre d’entreprises canadiennes privées, y compris de répertoires d’affaires sur Internet et la commercialisation de données, le développement de propriétés de villégiature au Canada, et le développement et l’octroi d’une licence de Smartboard, un produit technologique de construction breveté.» (Réd. A l’Encontre)

